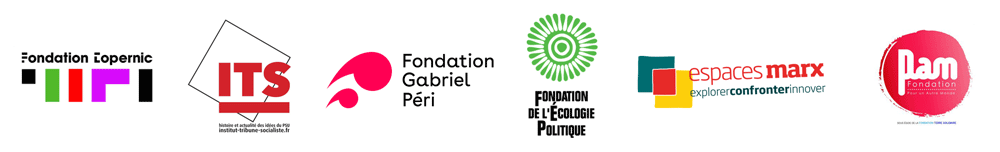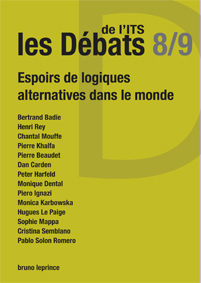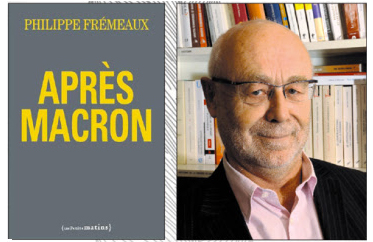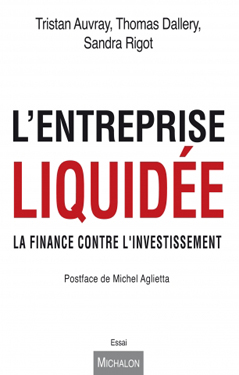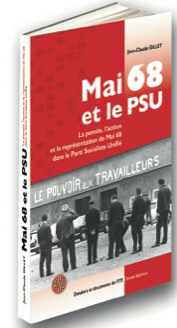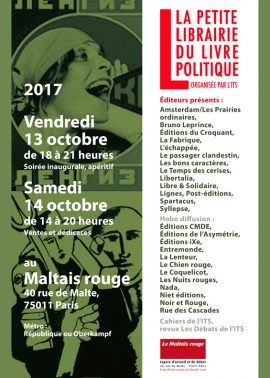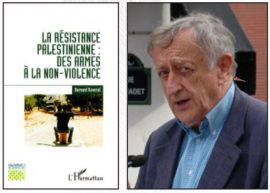Jacques a été une figure lumineuse de notre histoire. Il détestait qu’on le lui rappelle trop, qu’on le réduise à n’être qu’un emblème de mai 68. Pour lui la célèbre photo qui le montre défilant avec Daniel Cohn-Bendit et Alain Geismar le 13 mai en tête de l’immense manifestation qui se dirigeait vers Denfert Rochereau était l’image d’une imposture. Pompidou avait fait la chattemite, la Sorbonne avait été rouverte, les prisonniers du 3 mai venaient d’être libérés par la Cour d’appel. Mais la foule en fête scandait « ce n’est qu’un début, continuons le combat ».
Jacques n’était pas un fanfaron. Il était discret et – il faut bien dire le mot si rare en politique – modeste, tout aussi réfléchi et convaincant que convaincu, Il ne voulait pas être une vedette médiatisée, ce qui réduisait à une faribole trompeuse ce qu’il avait été en réalité, le porte-parole de l’UNEF, qu’il avait réussi à installer en tête du mouvement à côté des « enragés » de Nanterre , le mouvement du 22 mars, et des professeurs du SNES-SUP, cette UNEF qui malgré ses déchirements était le seul syndicat étudiant médiatiquement reconnu et apparaissait comme la preuve symbolique d’une adhésion de la masse des étudiants au mouvement.
La première fois que l’’on trouve son nom dans les archives du Monde, c’est le 25 avril 1968. Une assemblée générale de l’UNEF cherche à désigner un successeur à Michel Perraud qui a démissionné. « Monsieur Sauvageot » dont on mentionne qu’il représente l’UNEF de Dijon, vice- président, va être élu mais la bataille est rude. Ce candidat des ESU, les étudiants du PSU, est sérieusement contesté par ceux du Comité de liaison des étudiants révolutionnaires, « d’inspiration trotskyste » comme dit le journal. Un commando d’extrême droite arrive. La bataille est cette fois très violente. Il y a trois blessés dont un sérieusement. Les étudiants syndiqués quittent la salle sous la protection de la police. « Monsieur Sauvageot » reste vice-président.
Le 27 avril, pendant que Pierre Juquin, envoyé en éclaireur par le Parti communiste à Nanterre, est chassé de l’amphi « Che Guevara » par les « enragés », « Monsieur Sauvageot » tient une conférence de presse et dit que l’UNEF se refuse à donner un mot d’ordre de boycott des examens, souhaitant toutefois qu’une réflexion s’instaure chez les étudiants sur la question de la sélection à l’Université. Puis il proclame solennellement que « les conditions objectives seront remplies à la prochaine rentrée pour que les protestations étudiantes reprennent avec davantage d’ampleur ». Or nous sommes là à trois jours de l’explosion.
La mention suivante dans le journal est celle de son arrestation et de son placement en garde à vue le 3 mai avec Daniel Cohn-Bendit et Pierre Rousset. Cette fois le journal lui donne un prénom. Il l’appelle « Marc Sauvageot ». Cette étrange coquille peut apparaître aussi comme un lapsus calami révélateur d’une réalité reconnue car il y a bien un « Marc » dans cette histoire. Le bureau national du PSU soutient à fond ses étudiants et là, il y a l’ami Marc, Marc Heurgon, prodigieux tacticien, dont Jacques Sauvageot écoutera toujours les conseils intelligents et rusés, à la fois audacieux et sages.
Ces arrestations, bien qu’éphémères, l’occupation de la Sorbonne, puis les condamnations à de la prison un Dimanche par le Tribunal de Paris des protestataires révoltés, donnent un nouveau mot d’ordre aux manifestants : « Libérez nos camarades ». L’odeur des gaz lacrymogènes s’installe au Quartier Latin, le mouvement se met en marche.
Après, pendant un mois, chaque jour Jacques est dans la rue, dans les réunions effervescentes, et dans le journal. Sa parole est forte et ferme. Sage aussi, quant à la lumière de l’histoire on la relit aujourd’hui. Il avait perçu la force et la faiblesse du mouvement et nous pouvons mesurer aujourd’hui après cinquante ans, la nouveauté et la pertinence de sa parole. Il avait permis à l’UNEF de jouer un rôle essentiel accompagnant le mouvement, renforçant les avancées et évitant les dérives.
Je n’évoquerai qu’une image de lui forte et émouvante. Nous sommes à Charléty le 27 mai. De Gaulle a disparu, François Mitterrand pense que le pouvoir est à ramasser. Le Monde a confié à la plume lyrique de Jean Lacouture le récit de ces moments ; Pierre Mendès-France passe comme un curieux. Les accords de Grenelle ont été signés, arrachant au gouvernement et aux patrons de singulières avancées. Pourtant il y a dix millions de grévistes qui sont à l’unisson de ceux de Billancourt qui ont sifflé Georges Séguy le signataire des accords. On hue la CGT et le Parti communiste. La grève continue. Les syndicats, les associations, les divers mouvements défilent dans la combativité et l’allégresse, de milliers de calicots, de drapeaux rouges C’est Jacques qui ouvre et conclut le meeting. Il appelle à la construction d’une nouvelle société socialiste et il dit, ce qui est alors singulièrement courageux : « La violence peut se justifier. Aujourd’hui nous ne la croyons pas efficace en vue de la création rapide d’organismes capables de pousser le mouvement jusqu’à ses conséquences ultimes ».
Trois jours après c’est la fin. Manif de la peur et de la droite aux Champs Elysées. Quelques mots de De Gaulle revenu requinqué de sa rencontre avec Massu. « Elections piège à cons ». Le PSU s’y engouffre, Jacques est plus réservé. Ce n’est pas la perte de la bataille qui doit faire cesser la guerre.
Le 14 juin, parlant de lui l’Humanité écrit « Le mouvement étudiant n’a pas les dirigeants qu’il mérite » Quelle sottise.
Il est enfin nommé président de l’UNEF, qui se débat dans des guerres picrocholines et après avoir mené une ultime bataille interne, part faire pendant quinze mois son service militaire. Il travaille alors au PSU, écrit à la fois s dans Tribune socialiste le journal du Parti et dans Que faire ? où s’exprime la nouvelle tendance qui va s’organiser, la Gauche ouvrière et paysanne, la GOP. Nous quittons je crois ensemble le parti en 1972, continuons à essayer de constituer ce mouvement qui deviendra l’Organisation communiste des travailleurs et si les vieux combattants s’égayent, cherchent d’autres engagements ou se rallient au nouveau pouvoir socialiste, lui continue le combat.
Tout en s’engageant professionnellement dans le domaine de la culture, ce qui a été toujours une préoccupation majeure pour lui – y compris sur le plan politique – Jacques est dans une action militante persistante bien que très minoritaire. Bien après il se présente encore comme suppléant sous l’étiquette » Pour le socialisme et le pouvoir aux travailleurs « .
Jacques ne proclamait pas l’ostracisme dont il avait fait l’objet. Simplement, un jour de 1973, il écrivit à un journal qui avait affirmé qu’il refusait tous les postes qu’on lui proposait, simplement ceci : « Je n’ai encore jamais eu la possibilité de refuser quelque poste que ce soit : les nombreuses demandes que j’ai pu faire dans l’enseignement comme dans la fonction publique ou dans le secteur privé se sont toujours heurtées à un refus. Cinq ans après mai 68, le seul travail que j’aie trouvé et que je fasse consiste dans la réalisation, à titre de vacataire, d’enquêtes sur l’élevage en agriculture ».
A l’approche de la retraite, il va se consacrer à tenter de conserver le souvenir de ce que fut l’aventure des ESU, leur engagement et plus largement, la vie du PSU. A partir de début 2008, il collabore à la réalisation du livre “au cœur des luttes des années soixante, les étudiants du PSU “ qui retrace leur engagement collectif et à de nombreuses réunions-débat sur ce livre dans toutes les régions, en centrant ses interventions sur les leçons pour aujourd’hui des idées et des luttes du PSU dans cette période. Parallèlement, il s’est engagé, à partir de la commémoration en avril 2010 du cinquantenaire de la création du PSU, dans la création puis la mise en place de ce qui allait devenir l’Institut Tribune Socialiste, qui a pour objet d’une part d’entretenir, le patrimoine intellectuel hérité du Parti Socialiste Unifié (PSU) d’autre part de transmettre les idées et les valeurs de ce patrimoine dans les réflexions et les débats actuels.
Il s’y est pleinement consacré depuis cinq ans, œuvrant sans relâche au siège de l’ITS, 40 rue de Malte, à l’émergence des débats d’idées autour des grandes questions sociales et politiques d’aujourd’hui, parallèlement à la mise en place du centre d’archives et de documentation sur le PSU ; il y a consacré sa vie.
Un soir nous étions rue de Malte à une réunion d’anciens combattants qui préparaient le colloque qui doit se tenir la semaine prochaine sur les années PSU de Michel Rocard et Roger Barralis nous a appris l’accident stupide et son coma à la Salpêtrière. Le coup nous a atteint en plein cœur.
Le Président de la République vient de dire qu’il souhaitait qu’on commémore Mai 68 « pour en tirer des leçons qui ne soient pas ‘anti’ ou ‘pro’ « car 68 fut le temps des utopies et des désillusions et nous n’avons plus vraiment d’utopies et vécu trop de désillusions ». Et Jacques n’est plus là. Personne n’a le droit de parler pour lui. Mais ceux qui sont ici et le connaissaient bien peuvent seulement imaginer ce qu’aurait été sa colère de voir ce moment de sa vie célébré sous les ors de notre actuelle République entre deux lois sécuritaires et quelques ordonnances allant jusqu’à rayer de notre droit ce que furent les progrès que nous nous refusions alors à voir des accords de Grenelle.
Au-delà de notre chagrin, il nous reste, Jacques, à dire à ceux qui arrivent et ne connaissent que l’écume qui s’efface de ce que furent tes combats et même tes défaites, à dire aussi mais surtout cette indestructible volonté de continuer le combat pour construire enfin un monde plus juste.
Henri Leclerc